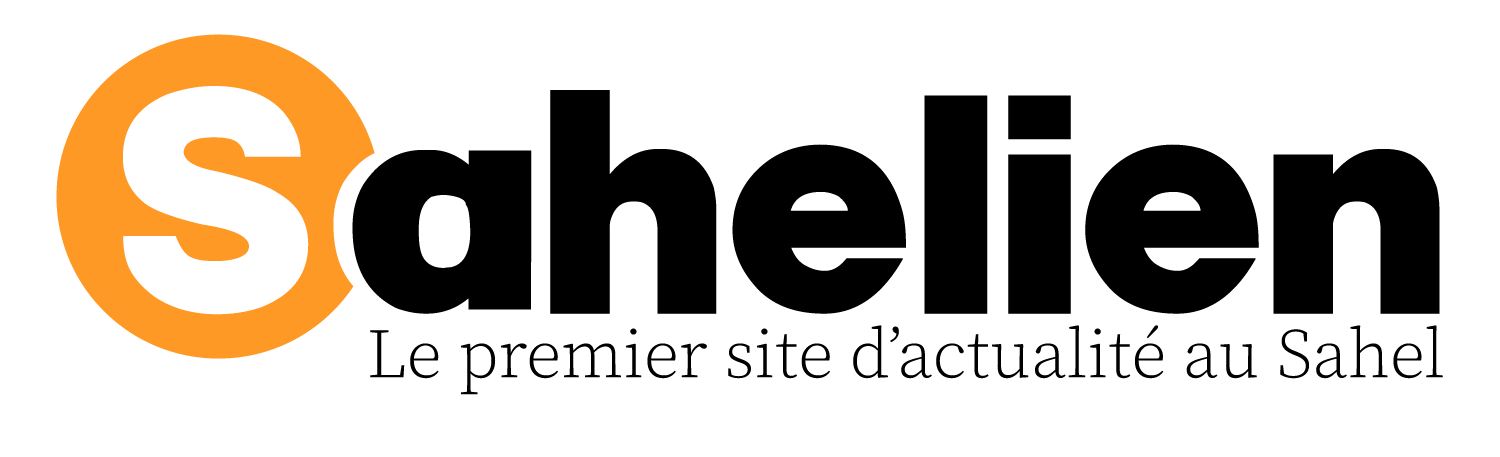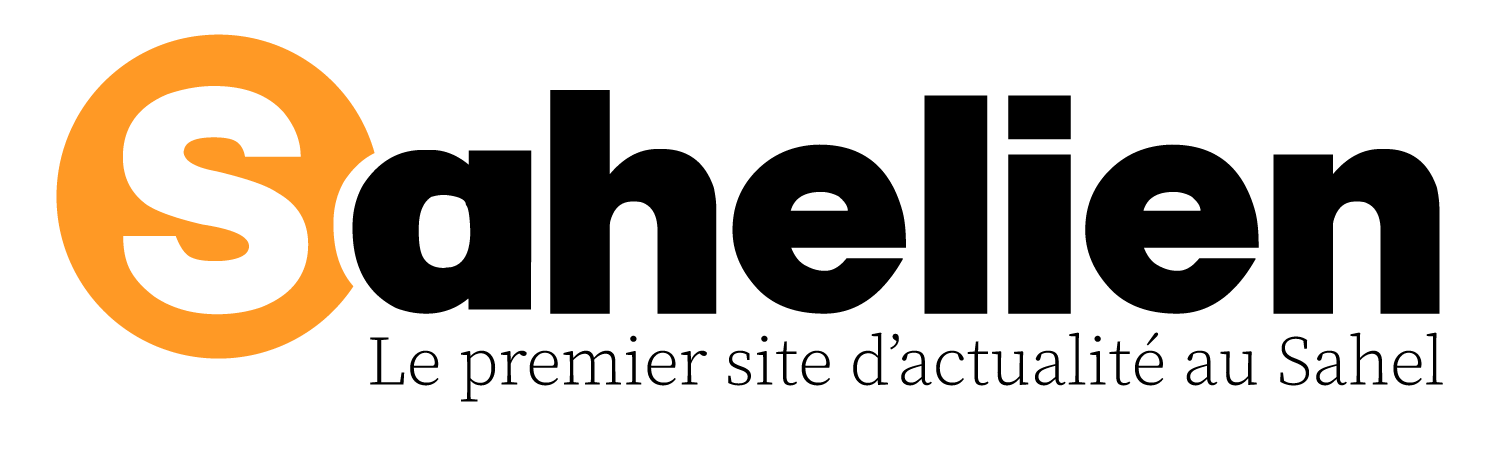Le 15 janvier, quand Ouagadougou a été violemment attaquée par des terroristes pour la première fois de son histoire, le nouveau gouvernement venait tout juste d’être nommé, après de longues journées d’attente. Les passations n’avaient pas encore eu lieu dans les ministères. Alors les nouvelles autorités ont paru, un instant, prises au dépourvu, estomaquées.
La sidération n’a pas duré. Le lendemain matin, le président et ses ministres se sont retrouvés pendant deux heures pour un Conseil extraordinaire. En sortant, un communiqué a annoncé un deuil de trois jours et plusieurs mesures sécuritaires. Les autorités se sont ensuite lancées dans une opération de communication. Elle n’a pas cessé depuis. Objectif : rassurer sur la sécurité dans le pays.
Mardi 19 janvier, moins de quatre jours après les attaques, le bilan des attentats était encore incertain. Les préoccupations allaient à l’enquête, l’identification des victimes. C’est alors qu’Alpha Barry a réuni le corps diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Dans la salle de conférence puis devant les journalistes, le nouveau chef de la diplomatie burkinabè a martelé son message : « le Burkina est un pays fréquentable ». Un discours destiné à tomber droit dans l’oreille des investisseurs étrangers.
Car les terroristes ont inoculé un puissant venin au Burkina Faso. Le pays s’est soudainement retrouvé sur la liste peu enviable des pays frappés par le terrorisme. Une liste qui fait fuir les étrangers. La presse ne s’y est d’ailleurs pas trompée. Passé le choc des attentats, l’hebdomadaire économique « Entreprise et innovation » a titré sur ce « coup de massue pour l’économie nationale ». « L’Economiste du Faso » s’est inquiété, pour sa part, du « cadeau des jihadistes », prévenant que « si la réponse à la menace terroriste n’est pas à la hauteur, tout le pays va se retrouver sinistré comme au lendemain de l’insurrection».
Car l’économie burkinabè traverse une passe difficile. Pendant une dizaine d’années, le Burkina Faso a affiché un taux de croissance entre 5% et 7%. En 2013, le taux de croissance était de 6,6%. Un bon élève de la sous-région, grâce notamment aux exportations d’or et de coton. Mais en 2014, la machine a ralenti. « Ça a commencé avec le débat autour de la question de savoir si Blaise Compaoré allait modifier ou non la constitution », se remémore Abdoulaye Tao, rédacteur en chef de « L’Economiste ». « L’année avant l’insurrection, les investissements avaient déjà commencé à baisser et l’activité économique à se contracter parce que les gens étaient dans l’incertitude ».
Certes, « en période électorale, il y a toujours un certain attentisme de la part des opérateurs économiques », relève Facinet Sylla, économiste spécialiste du Burkina Faso à la Banque africaine de développement (BAD). Mais cette inquiétude a été amplifiée par les interrogations sur le cadre institutionnel, même constitutionnel ». Loin de se décanter pendant l’année, le problème est devenu une impasse. Les 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso vit une insurrection. Blaise Compaoré est chassé du pouvoir par la rue. Ces troubles affectent l’économie. « On a assisté à une déflagration du conflit social. Et disons que presque tout le dernier trimestre 2014 a été perdu », pointe l’analyste. En 2014, le taux de croissance n’était que de 4,1%.
2015 n’est guère meilleur. « Il y a un coup d’Etat, l’arrêt de l’exploitation de certaines mines – la plus importante étant celle de Tambao (pour un problème de permis), des attaques terroristes… On savait que la transition n’était pas propice à une remontée forte du taux de croissance, mais on s’attendait à un taux de l’ordre de 5% », poursuit Facinet Sylla. Finalement, il devrait tourner autour de 4%.
Le coup d’Etat a-t-il pesé sur l’économie ? Oui, estime le professeur Idrissa Ouedraogo, spécialiste en macro-économie à l’université Ouaga II : au-delà des journées perdues, « quand vous avez ce type de chocs, c’est un signal négatif qui est envoyé aux acteurs économiques. Ces derniers le reçoivent et restent dans une position d’attentisme, de ‘wait and see’ ».
Le chercheur poursuit : « Quoi que l’on dise, une situation d’insurrection et de transition correspond à une situation d’incertitude, d’instabilité. On peut comprendre que les acteurs économiques, notamment les investisseurs, n’aiment pas beaucoup l’incertitude. Et cela peut jouer négativement sur le flux d’investissement entrant, notamment les investissements directs étrangers, les IDE. Tout naturellement, cela peut donc affecter le niveau de croissance dans notre pays. Même au niveau national il y a des hésitations pour ceux qui étaient capable d’investir ou de consommer dans le pays ».
Car il n’y a pas que les investisseurs qui se montrent frileux. Les ménages aussi : « En situation d’incertitude, on est prudent en termes de dépenses », remarque Abdoulaye Tao. « Si on veut acheter un nouveau véhicule, par exemple. Dans un climat de troubles, ou à tout bout de champ on brûle des voitures, on va forcément hésiter. Il y a une sorte de prudence dans les ménages. On attend de voir que le pays redémarre ».
Enfin, le couvre-feu qui a duré quatre mois a ralenti l’activité nocturne. « Il est difficile de bien mesurer l’impact du couvre-feu. Mais quand le pauvre fermier prend ses poulets bicyclettes, ils ne s’achètent pas car ils se vendent en général la nuit », relève Facinet Sylla.
Aux facteurs négatifs internes, il faut en ajouter d’autres, externes. Les cours de l’or et du coton ne sont pas à leur meilleur niveau : moins de devises, moins de recettes.
Finalement, « Les attentats sont arrivés au pire moment. On relevait à peine la tête. Après les élections (qui ont marqué la fin de la transition), l’horizon semblait débouché et voilà les attentats », souligne Abdoulaye Tao. Le professeur Ouedraogo abonde : « les attentats sont arrivés dans une situation cruciale. On pensait que le gouvernement mis en place pouvait maintenant se mettre au travail pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux ».
Or, « quand vous avez été victimes d’attaques terroristes, ça a un effet de stigmatisation très important », observe Facinet Sylla. Il dresse un parallèle avec la Tunisie où le tourisme s’est effondré : « Vous seriez à Tunis, vous diriez: ‘tout va bien’. Mais quelqu’un hors de Tunisie va vous dire : ‘non, il ne faut pas y aller, ce n’est pas le moment’ ».
Selon lui, certains effets des attaques terroristes peuvent même être comparables à Ebola : « Vous pouviez être à Conakry et mener l’activité que vous vouliez, vous n’auriez même pas senti qu’il y avait Ebola. Mais les hôtels étaient complètement vides. Les projets se sont arrêtés brutalement. Dans ce genre de phénomènes, l’effet stigmatisant induit est plus important que l’effet direct lui-même ». Du coup, alors qu’ « on projetait à plus de 6% le taux de croissance pour 2016, nous revoyons nos prévisions de croissance dans les environs de 5% ».
Dans un entretien à « Jeune Afrique », Félix Sanon, coordonnateur du forum de développement des entreprises en Afrique de l’ouest, Africallia, organisé en février, a admis que certains participants « hésitent à venir » : « Compte tenu des attaques, nous avons revu nos objectifs à la baisse car de plus en plus d’hommes d’affaires estiment que le Burkina est désormais dans le viseur des terroristes. Mais, nous leur disons que le Burkina reste et demeure une destination fréquentable ». A la Chambre de commerce comme au ministère de l’économie, le sujet semble sensible : ni l’un ni l’autre n’ont donné suite à nos sollicitations répétées.
Car aujourd’hui tous les regards se tournent vers le gouvernement. Il doit rassurer les investisseurs, estiment plusieurs observateurs. « Il faut mettre en confiance les acteurs économiques. Compte tenu des attentats jihadistes, que nous avons vécu, il faut tout mettre en œuvre pour qu’on sente qu’il y a une certaine sécurité. C’est un travail de longue haleine. Mais si la confiance n’est pas restaurée sur le plan de la sécurité, il sera difficile d’observer une relance de l’activité économique. C’est donc une question tout à fait cruciale », assure Idrissa Ouedraogo.
Pour Abdoulaye Tao, le gouvernement a d’ailleurs voulu jouer sur un ressort « psychologique » en levant le couvre-feu juste après les attentats, « C’est un signal pour dire : on maitrise la situation, elle n’est pas aussi catastrophique qu’on pourrait l’imaginer ».
Plus concrètement, en mars, le parlement doit voter une loi de finance rectificative. « Il est évident qu’une bonne partie des ressources ira dans le sécuritaire. Ça fait un manque à gagner pour l’économie, pour le secteur productif de l’économie. Mais c’est un mal nécessaire », estime le professeur Ouedraogo. Oui, « on s’attend à ce que le budget soit revu à la hausse de ce côté-là », juge Abdoulaye Tao.
Mais Facinet Sylla appelle à « ne pas opposer les besoins sécuritaires aux besoins de développement. Les besoins sécuritaires viennent renforcer le potentiel de développement. Quand il n’y a pas de sécurité, on ne peut même pas parler de développement. Donc il ne faut pas opposer les deux. Le gouvernement sera amené à faire des arbitrages. Mais dans ces arbitrages, il est bon qu’on ne fasse pas des dépenses d’investissement la variable d’ajustement. Sinon, on va lutter avec des objectifs de court terme et oublier les objectifs de développement. C’est avec les investissements en équipement, dans les infrastructures de transport, d’aménagement agricole, qu’on va résoudre le problème de la pauvreté ». Une pauvreté qui constitue un terreau fertile pour les groupes terroristes, précisément.
De plus, les attentes de la population sont très fortes après l’insurrection politique. L’année à venir sera peut-être socialement mouvementée. Facinet Sylla suggère, vu la situation, qu’« une trêve sociale » serait bienvenue : « Quand vous voulez tout tout de suite d’une même vache, vous allez l’étrangler. Vous ne pouvez pas avoir en même temps, le lait, le sang, la viande ».
Reste que le pays doit faire face à de grands défis. Pour Pierre Claver Damiba, consultant, ancien ministre et premier président de la BOAD (Banque ouest-africaine de développement), les bons chiffres du taux de croissance sont un trompe l’œil, car « ce n’est pas une croissance, car une croissance génère de l’emploi et créé de la valeur ajoutée. Or, ni l’un ni l’autre n’est généré par la croissance que nous avons. Ce n’est donc pas une croissance de transformation, mais une croissance comptable ». Il pointe que le Burkina Faso n’a « pas de secteur secondaire », que les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas soutenues, l’enseignement supérieur dépassé, la corruption endémique, les multinationales boudent le pays… Autant de « contraintes macro-économiques au développement », selon Pierre Claver Damiba. « Tant qu’on ne se libère pas de ces grandes contraintes macro-économiques, on ne peut pas avancer ».
« On court derrière les événements, mais on ne traite pas le fond du problème », déplore Pierre Claver Damiba. « Ce que je crains pour le Burkina Faso, c’est ce qui arrive aujourd’hui à la Tunisie. Les Tunisiens ont fait leur révolution en 2011, mais ils sont à nouveau dans la rue car rien ne s’est passé. Si on ne traite pas les problèmes fondamentaux, ils vont nous accompagner et grossir. Et le phénomène tunisien, nous risquons de le connaître ici. Depuis l’année dernière les jeunes sortent en disant : vous n’avez rien fait pour nous. Il n’y a pas d’emploi, il n’y a pas de création de valeur ajoutée, la pauvreté s’accroît. Les causes qui ont entraîné le départ de Blaise, il faut les traiter à fond et sans délai ».