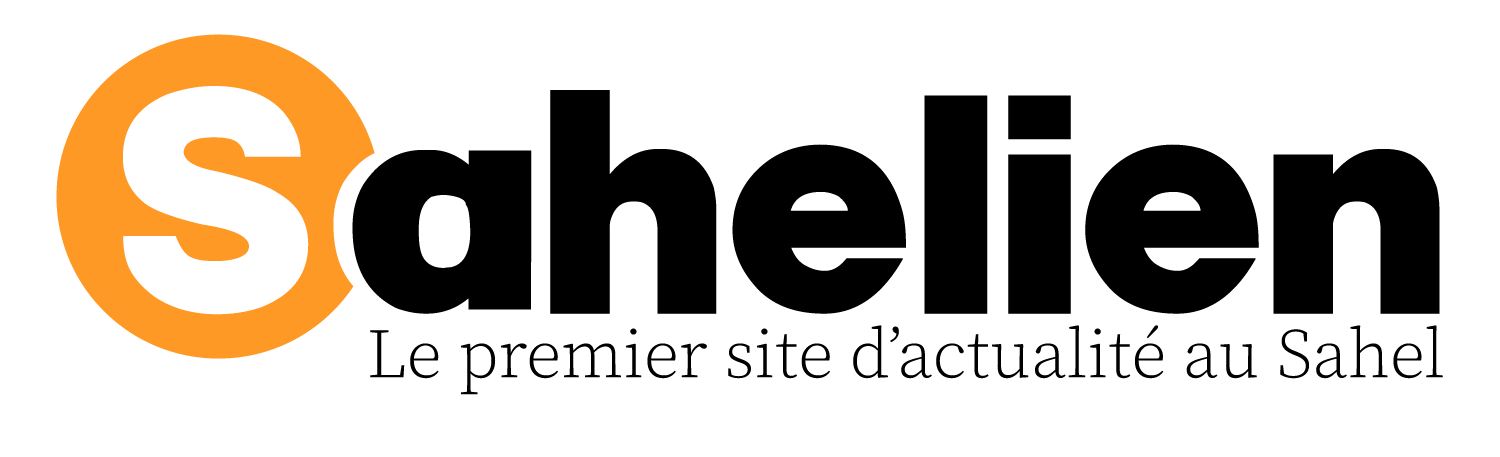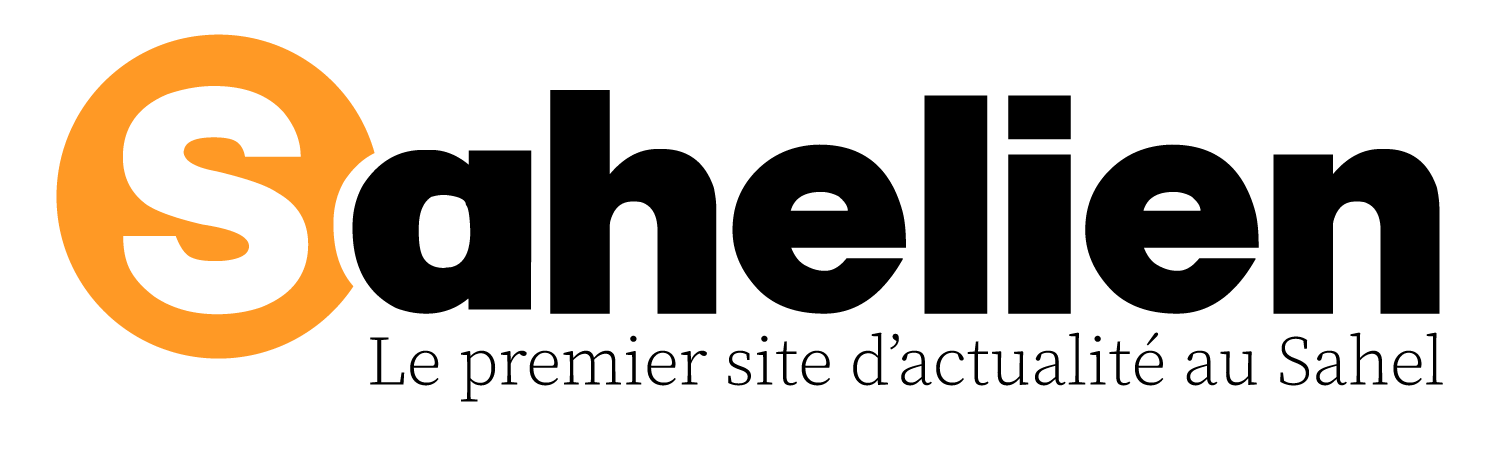Par Hauwa Shaffii Nuhu
« Nous comprenons maintenant les couches de traumatismes publics qui ont formé la psyché de nos parents. Ils n’étaient pas la génération silencieuse. Ils étaient traumatisés. Imaginez ce que nous avons vu au cours des deux dernières semaines, encore et encore pendant des décennies » – Gbenga Adesina, à propos des manifestations de #EndSARS.
20 octobre 2020
19H20.
Ce soir, je suis assise dans la voiture avec l’homme que j’aime. Nous parlons et nous nous taquinons. Je l’implore de prendre ses médicaments soigneusement. Nous parlons de l’enfance, de l’école et de l’influence de ses pairs. Nous rions de cette façon que seule l’affection peut puiser dans votre cœur. Quand je sors de la voiture et que j’entre dans la maison, il s’en va. Je commence à surfer sur mon téléphone qui est verrouillé depuis une heure environ.
20h11.
Sur Twitter, je cite le tweet de Bulama Bukarti de mon essai sur le meurtre d’Hassan Alfa, pour dire merci, et j’y inclus le hashtag #EndSARS. Ensuite, je le fais défiler vers le bas et je le vois.
Kemi a tweeté The Lekki Toll Gate Massacre, 2020, et soudain, il n’y a plus assez d’air dans le monde. Je quitte immédiatement l’application Twitter, comme si plus vite j’appuyais sur le bouton « Home », plus vite le tweet devient un mensonge. Je tiens ma tête dans mes mains parce que soudain, elle me fait mal et menace de se fendre.
Nous savions tous, après l’annonce du couvre-feu de 24 heures par le gouvernement de l’État de Lagos plus tôt dans la journée, qu’il y aurait des violences, que tous les manifestants dispersés autour de la mégapole déjà célèbre pour ses embouteillages et ses problèmes de circulation n’auraient aucun moyen de rentrer chez eux à temps, même s’ils le voulaient. Nous savions tous que la police pourrait utiliser l’excuse du respect du couvre-feu comme une occasion de déclencher la violence sur des manifestants pacifiques.
Mais il y a un fossé entre le savoir et le vivre.
Un massacre ? Non. C’est trop, même pour le Nigeria. Peut-être que ce n’est pas si grave. Peut-être que je devrais retourner sur Twitter pour confirmer le vrai état des choses.
J’ouvre à nouveau l’application et mon pays est en feu.
Je continue à défiler. Chaque tweet parle de la violence et ceci est clair : les citoyens nigérians, qui protestaient pacifiquement contre la brutalité policière depuis deux semaines, étaient assis par terre à la porte de péage de Lekki, tenant le drapeau nigérian et chantant l’hymne national. Ils avaient été barricadés par l’armée nigériane, puis ils ont été arrosés de balles réelles. Il y a un flux en direct des événements sur l’Instagram de DJ Switch. J’envisage de rester sur Twitter, en limitant mon souvenir de cette journée à des textes et non des vidéos – pour que cela soit plus facile à gérer par la suite. Mais je me sens mal dès que j’y pense.
Il y a des gens qui meurent en ce moment même au péage de Lekki, le moins que vous puissiez faire est de laisser votre corps témoigner de ce carnage, de cette violence.
Quand je trouve le flux en direct, il est sanglant, gore et sombre. Il y a un jeune homme avec une balle dans la cuisse, il gémit de douleur qui semble trop agonisante pour n’être que de la douleur ; le souffle est râpeux et haut et insupportablement rapide, comme s’il essayait d’atteindre quelque chose mais à chaque souffle il s’essouffle, et donc il essaie à nouveau. Ses camarades manifestants pacifiques tentent de le sauver au milieu des tirs et courent pour essayer d’extraire la balle de sa cuisse à mains nues. Ils ont utilisé un drapeau nigérian pour couvrir partiellement la blessure afin d’atténuer le saignement, mais comme pour tout ce qui est nigérian, ce n’est pas suffisant. Le garçon crie « laa ilaaha illAllah », il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah. Sa voix est fendue au milieu, et ce que nous entendons n’est pas vraiment une voix témoignant de l’unicité de Dieu, ce que nous entendons, ce que nous entendons vraiment, est une incroyable fissure faisant écho aux mots qui se trouvent à la base d’un corps maintenant presque vide. Sa voix s’approfondit et s’estompe d’un seul coup, son corps se relâche, s’enfonce de plus en plus profondément dans les corps des personnes qui le tiennent et qui essaient de le sauver.
Il est en train de mourir.
Je quitte l’application. Je descends de la chaise et m’assieds par terre dans ma chambre, le dos au lit.
Qu’est-ce que je viens de regarder ?
J’approche mes genoux tremblants de ma poitrine, je serre mes jambes fermement et je pleure comme si j’avais perdu un être cher. Parce que c’est le cas. Un pays. La foi. L’espoir. Il y a des choses que je ne peux pas nommer qui se répandent dans mon corps. Celles que je reconnais sont la peur, la colère, l’incompréhension. Mais celle qui me paralyse le plus est l’incrédulité.
Comment cela a-t-il pu se produire ?
Je me demande combien d’autres nigérians dispersés dans le pays, dans le monde, sont liés par cette douleur, en pleurant, comme moi. Blessés, comme je le suis. Des milliers, probablement ; il y avait plus de cent mille personnes qui regardaient le direct avant mon départ. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, je sais – l’humour, le sarcasme, la gentillesse et même la générosité. Même la douleur. Mais ça, c’est un nouveau tissu, lourd dans sa teinte. Z, l’une de mes personnes les plus proches, m’a dit plus tard : « Je me souviens d’être allé aux toilettes parce que mon dîner est revenu tout de suite … Ce dont je me souviens le plus, c’est d’avoir pleuré – quelle était la valeur de la vie pour ces gens ? »
Plus tard, quand je retourne sur Twitter, je trouve des tweets disant que le jeune homme est mort. Le drapeau nigérian était enroulé sur sa cuisse, Dieu sur sa langue. La rumeur dit qu’il s’appelait Jide.
Z a une fascination pour les noms et leurs implications. Je suis plus intéressée par le fait de nommer les choses que par le fait que les noms des gens sont des portails sur leur identité et leur vie. Mais avec chaque chose qu’elle écrit sur les noms, je me rapproche de la compréhension de l’importance de ces derniers.
Jide. Olajide. La chance est venue. La richesse est revenue.
Le Nigéria devait-il en finir avec lui, retourner son nom contre lui ? Que signifie pour un pays de se moquer ainsi de son propre peuple ? Tourner son nom jusqu’à ce qu’il soit à l’envers ? Pourquoi Jide a-t-il dû subir un tel sort ? Qu’est-ce que ses parents avaient à l’esprit lorsqu’ils l’ont appelé Jide ? Pourquoi tout cela se produit-il ?
12h11.
Je suis maintenant au lit, tout autour de moi il y a le silence et le silence. Je suis sur mon téléphone, à la recherche de mises à jour. Il y a un autre flux en direct, les tournages se poursuivent. Nous pouvons encore les entendre. Sur les médias sociaux, nous sommes témoins, nous veillons.
* * *
Avant le début des manifestations de EndSARS, le concept de brutalité policière avait toujours été une chose qui m’affaiblissait et sur laquelle je me sentais impuissante. Plus tôt dans l’année, alors que j’étais à la faculté de droit nigériane avant que le COVID-19 ne frappe, ma colocataire Aisha et moi avons eu une conversation à ce sujet, en particulier sur la technique brutale de Tabay utilisée par le SARS, telle que rapportée par la BBC dans un documentaire , pour torturer les gens. Elle avait voulu faire son mémoire de fin d’études sur ce phénomène à Kano à l’époque où nous étions à l’université, a-t-elle dit. Mais sa famille avait peur pour sa sécurité, car cela nécessiterait une enquête approfondie de sa part. Elle a donc décidé de ne pas le faire. Nous avons parlé du cas de Hassan Alfa, qui avait été horriblement assassiné par le SARS à Kano.
Je me suis souvent retrouvée à penser à Hassan ; qui il était, quels avaient été ses rêves, ce qu’il aurait pu être. Ce que je ressentais était toujours une rage et une douleur impuissantes mais paralysantes.
Lorsque les manifestations ont commencé en octobre, ma rage et ma douleur n’étaient plus des choses lourdes, immobiles ; elles pouvaient maintenant se déplacer. J’ai donc fait des efforts et établi un lien avec la famille de Hassan Alfa. J’ai parlé à son père et à son frère au téléphone, et j’ai écrit au sujet d’Hassan.
Il y avait quelque chose de déchirant et de puissant dans la voix du père d’Hassan lorsque nous avons parlé au téléphone ce soir-là. Cela m’a brisé le cœur et j’ai pleuré plus tard, mais cela m’a aussi donné du pouvoir. Je ne l’ai pas compris à ce moment-là. Je l’ai compris, beaucoup plus tard, dans un endroit inattendu.
Dans une vidéo montrant un autre groupe de manifestants pacifiques assis sur le sol au poste de péage, ils chantent l’hymne national alors même que les tirs se poursuivent. On a l’impression de voir un édifice en ruine, maculé de sang et de poussière, mais debout. L’homme qui tient le téléphone et qui fait l’enregistrement chante aussi l’hymne. Alors qu’il s’approche des derniers versets, les coups de feu deviennent plus forts, plus rapides et plus rapprochés. Sa voix est grave, mais maintenant elle se brise et il se met à pleurer. Cela ressemble à un grattement de force poussé sur ses genoux contre un sol durci. Mais toujours de la force. Les vers ne restent pas coincés dans sa bouche, il n’avale pas les mots, il les prononce à travers ses larmes, entouré de coups de feu qui retentissent, jusqu’à ce qu’il prononce les derniers mots, « paix et unité ».

Je reviens déjà à la vidéo, même si elle me fait pleurer. Ma jeune sœur me demande pourquoi.
« Pourquoi tu continues à te faire ça ? ». « C’est trop douloureux, trop déprimant », dit-elle, et ses yeux sont pleins de larmes qu’elle retient. Elle a 17 ans.
« Je ne veux pas oublier », dis-je. Mais on ne peut pas oublier une voix comme celle-là, même si elle n’a été entendue qu’une seule fois. Il n’y a pas d’oubli de cette agonie.
Je reviens à cette vidéo parce que la voix de cet homme m’a finalement fait comprendre ce qui, dans la voix du père d’Hassan, m’a tant affectée : elle était provocante même dans un état de brisement et de défaite. Je reviens à la vidéo pour ressentir cette défiance. Je veux ressentir de temps en temps de l’espoir et de la détermination, même dans mon esprit brisé.
J’ai vu ce qu’un traumatisme sans issue a fait aux générations passées et à la génération actuelle.
Notre traumatisme se manifeste dans la façon dont nous plaisantons. Nous utilisons l’argot « jaapa » pour exprimer le désir de fuir ce pays chaque fois qu’il nous porte un coup cruel, nous utilisons les « memes » pour éteindre et condenser nos douleurs en quelque chose d’assez petit pour passer dans notre gorge, afin qu’il n’y reste pas longtemps. Nous nous sentons coupables de tout ce qui s’est passé, puis nous sommes consumés par la résignation, qui est une sorte de mort cruelle.
Mais nous devenons aussi quelques temps après apathiques face à la violence et aux tragédies. C’est pourquoi un mois et demi plus tard, nous apprendrons que des centaines de garçons ont été enlevés dans une école de Katsina, et pour certains, l’indignation prendra la forme de plusieurs feuilles mortes.
Nous devenons également violents, d’abord dans les espaces privés, puis dans les espaces publics : perdant inconsciemment notre capacité à trouver ces choses répugnantes, nous commençons à les reproduire. Nous invitons les soldats et les policiers à intimider les personnes avec lesquelles nous avons de petites querelles personnelles, nous cherchons à les soumettre, à leur faire perdre le moral. Et un cycle pourrait bien naître.
De nombreux nigérians ont tweeté sur le fait de vivre leurs journées normalement, puis se sont souvenus de scènes du direct du 20 octobre, et soudain ils replongent dans le chagrin. C’est comme ça pour moi aussi. Une fois, à midi, j’essayais de dormir et, en fermant les yeux, j’ai immédiatement été attiré par un rôle dans un essai sur le meurtre d’un jeune homme nommé Rinji, par le SARS au début de cette année. L’auteur avait rapporté que lorsque le corps de Rinji a été retrouvé, ils ont vu qu’il avait essayé de ramper loin de l’endroit où il avait été tué, son sang le traînant, jusqu’à ce qu’il finisse par arrêter de respirer et donc de bouger. C’est une image qui me hante, qui m’a empêchée de dormir cet après-midi-là, et bien des après-midis par la suite.
Il n’est pas normal qu’une génération entière soit aussi traumatisée, aussi effrayée.
Je reviens donc à cette vidéo des personnes qui chantent l’hymne national, pour trouver une lumière, aussi minuscule soit-elle, dans cette obscurité dévorante. Je me dis que si une personne confrontée à une mort presque certaine choisit de prononcer le nom de son pays pourquoi ne devrais-je pas, assis dans la sécurité de ma chambre, au moins le tenir dans mon cœur ?
Le nationalisme et le patriotisme des nigérians m’ont toujours profondément frappée. Voici un pays qui n’a apporté à la plupart d’entre nous que de la douleur, et pourtant, lorsqu’une personne constate que ses droits sont violés, elle est la plus susceptible de dire pour se défendre : « Je suis un citoyen de ce pays, vous ne pouvez pas me traiter comme ça ». J’ai entendu cette phrase tant de fois, et ce ne sont pas tant les mots que la fierté et la dignité dont elle est enrobée qui me réchauffent le cœur. Nous portons notre nigérianité avec dignité et fierté : dans notre vocabulaire, dans la façon dont nous continuons à agiter les drapeaux lors des manifestations. Même dans la façon dont nous demandons au pays de cesser de nous tuer.
Un Nigérian à qui l’on demande de se présenter est plus susceptible de mentionner sa nationalité avant de mentionner son nom réel.
* * *
Mon amant et moi partageons trois langues.
Je suis très investie dans la langue, dans la communication. Mais mon amour et ma connaissance de la langue signifient aussi que je sais qu’il y a des jours où la langue ne suffit pas, où vous irez chercher les mots dans votre cœur sans pour autant les prononcer. Rien d’autre que la douleur qui se répand de l’intérieur de votre corps vers l’extérieur.
Le fait d’avoir plusieurs langues à notre disposition signifie que j’ai souvent trois chances de m’exprimer devant lui. Si je ne pouvais pas me souvenir d’un mot en anglais, je l’exprimais en Hausa. Si j’en étais incapable, je m’essayais avec le Nupe pour le chercher. Souvent, nous avons eu des conversations dans ces trois langues. Une fois au téléphone, il a dit d’une bouchée et en haoussa qu’il avait mangé du qoda. Je ne savais pas ce que c’était. « Gizzard », traduisait-il.
« Oh », ai-je dit.
J’en suis venue à concevoir ce passage aisé à travers les langues comme une forme d’intimité.
Lorsque l’attaque au péage a eu lieu, les trois langues combinées n’ont pas pu nous sauver du silence.
* * *
La première fois que j’ai entendue parler du massacre de la vallée de l’Iva en 1949, c’est le positionnement stratégique et le processus de la tuerie qui m’ont fait tourner la tête – comment les attaquants ont formé une ligne, debout sur une colline, et ont fait pleuvoir des tirs en bas. C’était complètement sans cœur, sans aucun égard pour la vie humaine. Les mineurs de la vallée de l’Iva ont protesté pacifiquement contre les conditions de travail atroces que leur imposait le gouvernement européen, ils ont chanté et dansé pendant qu’ils protestaient, et la réponse de la police coloniale a été de les abattre et de les tuer. Ils ont tué 21 personnes, dont la plupart ont reçu une balle dans le dos. Cinquante et un autres ont été blessés. Parce qu’ils demandaient des conditions de travail équitables.
Ils avaient chanté, tout comme les manifestants pacifiques de la porte du péage de Lekki avaient chanté l’hymne national. Ils n’étaient pas armés.
Comment expliquer qu’une force de sécurité tire à balles réelles sur une foule qu’elle est chargée de protéger, parce que cette foule proteste contre des exécutions extrajudiciaires ? Avec le massacre de la vallée de l’Iva, il était facile d’imaginer qu’une telle atrocité était possible parce que la relation entre une colonie et son colonisateur était déjà marquée par une oppression violente. Le massacre était la continuation de cette histoire.
Mais avec l’attaque du péage, c’était plus déconcertant, plus traître. Ce qu’il a fait a prouvé encore une fois l’argument que les universitaires ont longtemps avancé : que la police – coloniale ou contemporaine – et l’État sont une seule et même chose, et cela explique pourquoi au-delà de la brutalité policière, #EndSARS était également une question de mauvaise gouvernance.
* * *
Ma génération est légitimement fière de beaucoup de choses, dont l’une est « nous n’avons pas hérité du silence de nos ancêtres ». C’est une puissante affirmation, sauf que nos ancêtres ne se sont pas tus, ils ont été tués. Ceux qui ont survécu ont vu leur esprit brisé et battu jusqu’à l’inaction et le mutisme, ce qui est une autre sorte de mort. Mes propres parents, bien qu’ils comprennent la fureur qui nous anime, ont une position détachée. Ils sont incapables de se résoudre à espérer ou même d’imaginer que l’histoire sera cette fois-ci clémente. Que nous allons triompher.
Et donc, il n’est pas tout à fait vrai que les générations passées se sont tues. Ceux qui ont survécu ont vu trop d’horreur pour continuer à se battre. Nous avons tous ressenti ce sentiment dans nos différentes maisons la nuit du 20-10-2020, et par nos corps ayant absorbé tant d’autres tragédies.
« J’ai l’impression que nous vivons le pire des temps », ai-je dit à un ami cher, J, lorsqu’il m’a envoyé un texto pour vérifier si tout allait bien.
« C’est vrai », a-t-il répondu, « Nous le sommes. Chaque jour, je me réveille effrayé ». Il est aux États-Unis pour obtenir son AMF, mais la terreur est la même. « C’est dur. J’ai juste peur qu’une terrible nouvelle m’atteigne. J’ai prié », dit-il.
* * *
L’armée nigériane a nié avoir été au péage cette nuit-là.
Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a d’abord déclaré le lendemain matin à la télévision que personne n’était mort. Plus tard, il a reconnu que le gouvernement avait effectivement invité l’armée à « maintenir la paix ».
L’armée a reconnu plus tard, lors d’une des commissions judiciaires mises en place à Lagos pour enquêter sur les meurtres du SARS, qu’elle avait été présente au poste de péage. Ils ont ensuite déclaré qu’ils n’étaient pas en possession de balles réelles et qu’ils n’avaient tiré qu’à blanc. Après que les preuves vidéo et l’analyse médico-légale aient montré qu’ils avaient effectivement tiré des balles réelles, ils ont admis qu’ils avaient été présents avec des balles réelles, mais qu’ils ne les avaient pas utilisées.
Les récits des événements dont nous avons été témoins en direct, dont tant de personnes ont été témoins en chair et en os, ont été niés avec tant de véhémence, tant d’insistance. C’était exaspérant au-delà des mots. Mais je reviens aux notes que j’avais prises au moment où ces choses se produisaient, je reviens à ces notes que j’avais prises pour défendre la nature fugace de la mémoire, et je sais que nous n’avons pas tous simplement évoqué ces moments. Ils nous avaient vraiment tués.
Certains d’entre nous ne s’en remettront jamais. Certains d’entre nous prévoient, quelques semaines plus tard, de retourner dans les rues pour une nouvelle vague de protestations. Parce que l’histoire est cyclique, nous reconnaissons que ceux qui sont au pouvoir utilisent les mêmes tactiques qu’ils ont utilisées pour soumettre nos parents, sur nous. Je crains parfois qu’ils ne réussissent, car il y a des limites à ce qu’un peuple peut absorber.
Mais si une génération a fourni de manière désintéressée de la nourriture gratuite lors des manifestations tous les jours pendant deux semaines, a collecté 145 millions de Naira en dons en deux semaines, a mis en place une infrastructure juridique pour sauver les manifestants détenus illégalement, a fourni des imperméables aux manifestants lorsqu’il a commencé à pleuvoir, a mobilisé des ambulances privées au péage de Lekki après les tirs pour sauver les blessés, si une génération est restée assise à chanter l’hymne national alors même que les coups de feu se sont fait entendre au loin, alors peut-être, peut-être, cette génération n’est pas brisable.